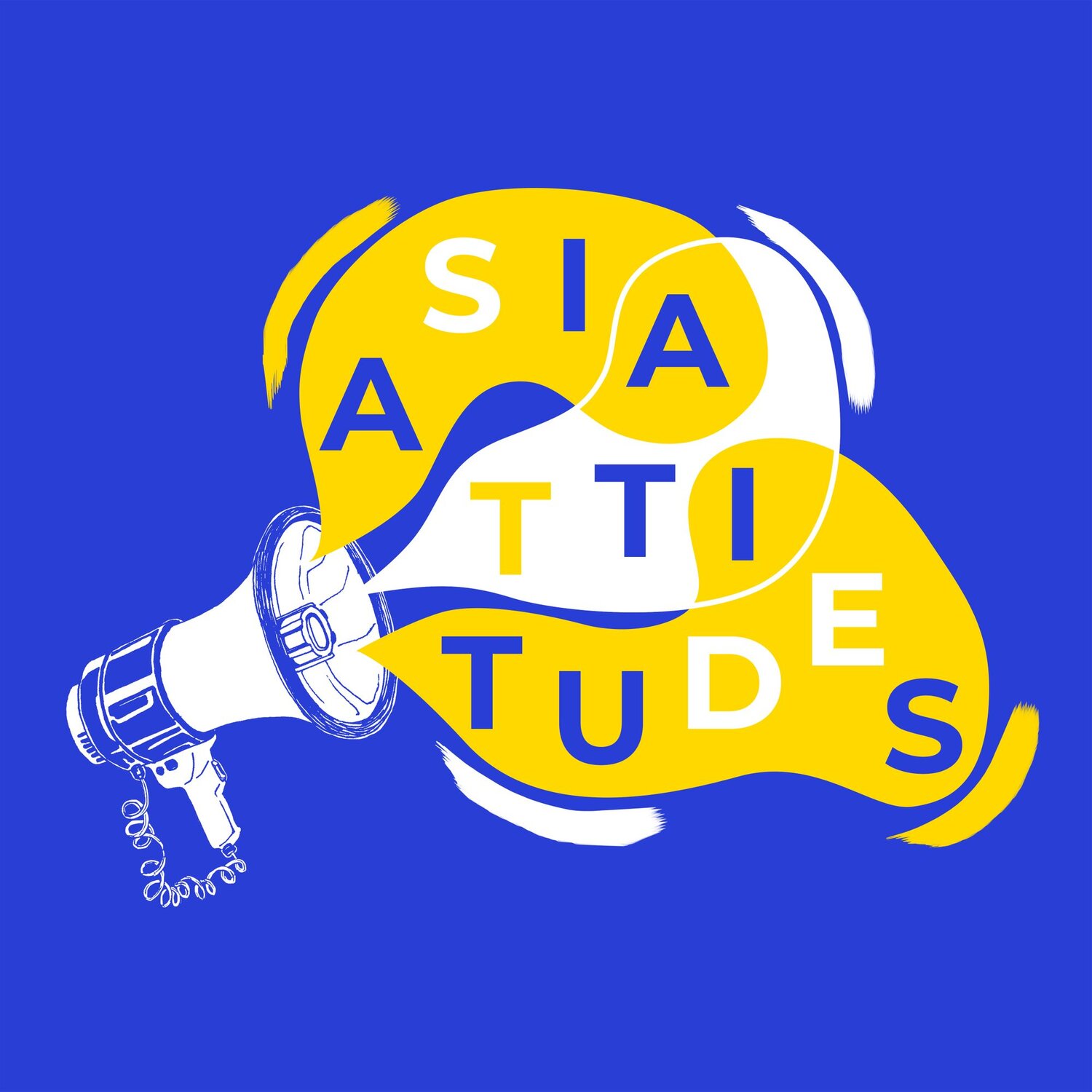Blessures invisibles : les effets du racisme anti-asiatique sur le soi
Un racisme « ordinaire » mais profondément blessant
Contrairement aux représentations dominantes du racisme comme une violence brutale ou explicite, le racisme anti-asiatique prend souvent une forme plus subtile, dite « ordinaire » : des blagues racistes au bureau, des remarques insistantes sur les origines, ou des assignations implicites à certains rôles sociaux. Ces micro-agressions sont définies en psychologie comme de brèves remarques ou gestes stigmatisants envers des groupes minoritaires. Ils peuvent sembler anodines isolément, mais leur répétition constante génère une forme d’usure psychologique.
Pendant la pandémie du Covid-19, ces tensions se sont intensifiées. Une étude menée par Cheah et ses collaborateurs (2020) révèle que de nombreux enfants et parents sino-américains ont subi une forte augmentation des agressions verbales et du harcèlement, provoquant chez eux de l’anxiété, un repli sur soi et une perte de confiance.
En France aussi, les témoignages récoltés par Simeng Wang (2023) révèlent des expériences similaires : stigmatisation, dévalorisation et isolement, le tout rarement dénoncé. Selon cette étude, les personnes d’origine asiatique rapportent fréquemment des formes de racisme banalisé : moqueries à l’école (« tu sens les nems »), assignations raciales au travail, harcèlement sexuel dans l’espace public. Pour les jeunes Asiatiques diplômé·es interrogé·es, ces humiliations répétées dès l’enfance construisent une «blessure identitaire silencieuse ».
Du point de vue de la psychologie , ces expériences participent pleinement de la dynamique des micro-agressions raciales : elles sont quotidiennes, souvent minimisées, et rarement reconnues comme des formes «sérieuses » de racisme. Pourtant, leur impact est bien réel. À long terme, elles génèrent une forme d’usure psychique que certains chercheurs désignent sous le nom de « racial battle fatigue » — une fatigue émotionnelle et cognitive liée à l’exposition chronique à des agressions raciales (Smith et al., 2007).
Lutte intérieure : Identité, honte et surcompensation
Quand une personne est renvoyée en permanence à sa différence (« T’es d’où ? », « Tu parles bien français »), elle peut développer ce que les psychologues appellent un conflit identitaire. Ce conflit naît d’une tension entre l’image que la société projette sur elle (étrangère, obéissante, neutre) et l’image qu’elle a d’elle-même. Il peut provoquer un sentiment de honte, une difficulté à s’affirmer, ou au contraire une forme de surcompensation (travailler plus, chercher à prouver sa valeur).
Sur le plan psychologique, l’un des effets les plus insidieux du racisme anti-asiatique est la honte internalisée. Être perçu comme « différent·e », finit par entamer le sentiment d’appartenance. Beaucoup de personnes concernées développent des stratégies dites de surcompensation : redoubler d’efforts à l’école ou au travail, se rendre « irréprochable”, pour mériter leur place.
Ce phénomène s’appuie sur un stéréotype très spécifique : celui de la « minorité modèle », qui présente les Asiatiques comme travailleurs, dociles, et silencieux. S’il semble flatteur, ce cliché empêche aussi les personnes concernées de parler des injustices qu’elles subissent. Une méta-analyse récente de Tran et al. (2021) confirme que cette pression à la conformité bloque souvent l’accès à des stratégies de coping saines, comme l’expression des émotions ou le recours à l’aide. L’étude de Wang (2023) également révèle que de nombreuses personnes asiatiques développent des stratégies d’adaptation fondées sur le silence, l’effacement ou le perfectionnisme. Ce type de comportement peut s’interpréter à travers l’idée selon laquelle il faut être exemplaire pour se faire accepter, même au prix de son bien-être psychologique.
Le racisme genré : entre hypersexualisation et emasculation
Les stéréotypes racistes ne sont pas neutres du point de vue du genre. De nombreuses femmes asiatiques décrivent des situations de racisme sexiste : elles sont abordées dans la rue, hypersexualisées et fétichisées sur les applis de rencontre, considérées comme « dociles » ou « exotiques ». Dans le monde du travail, cela se traduit parfois par une infantilisation.
Chez les hommes, on observe l’effet inverse : ils sont souvent perçus comme peu virils, « efféminés » ou socialement insignifiants. Ces représentations dévalorisent leur masculinité et peuvent générer un sentiment d’inadéquation dans les relations sociales ou amoureuses (Chen, 1999; Lee et al., 2022). En psychologie sociale, on parle d’intersectionnalité : le fait que les discriminations ne se vivent pas de manière isolée, mais s’entrecroisent. Les stéréotypes genrés spécifiques aux Asiatiques renforcent leur marginalisation, dans l’intimité comme dans la sphère professionnelle.
Vigilance constante, solitude et santé mentale fragilisée
Face à la crainte constante d’être jugé·e, rejeté·e ou agressé·e, beaucoup de personnes asiatiques développent une forme d’hypervigilance sociale. C’est-à-dire une attention accrue à leur comportement, leur façon de parler, leur apparence. Chae et al. (2021) parlent à ce sujet de « vigilance raciale », un mécanisme de défense qui, à long terme, augmente l’épuisement psychologique et les troubles anxieux.
Pour les adolescent·es, ces effets sont d’autant plus préoccupants qu’ils interfèrent avec la réussite scolaire, la qualité du sommeil ou la construction de l’estime de soi (Yip et al., 2019). Pourtant, très peu de personnes consultent. Le silence est encore la norme. Le racisme anti-asiatique reste un tabou, renforcé par des normes culturelles (ne pas « perdre la face ») et un manque de reconnaissance institutionnelle.
Redonner du pouvoir à nos récits
Face aux effets psychologiques du racisme, il est crucial de valoriser les récits personnels, de reconnaître la violence des expériences vécues, et de construire ensemble des réponses collectives. Nommer les choses, c’est déjà leur résister.
Dans le prochain article, nous explorerons les formes de résistance, les ressources collectives et les actions possibles pour reprendre du pouvoir, sur nos récits, nos émotions et nos appartenances.
Références
Chae, D. H., Yip, T., Martz, C. D., Chung, K., Richeson, J. A., Hajat, A., & Gee, G. C. (2021). Vicarious racism and vigilance during the COVID-19 pandemic: Mental health implications among Asian and Black Americans. Public Health Reports, 136(4), 508–517. https://doi.org/10.1177/00333549211018675
Cheah, C. S. L., Wang, C., Ren, H., Zong, X., & Leung, C. Y. Y. (2020). COVID-19 racism and mental health in Chinese American families. Pediatrics, 146(5), e2020021816. https://doi.org/10.1542/peds.2020-021816
Lee, S., Waters, S. F., & Raval, V. V. (2022). “They treat me like I’m Asian”: Discrimination experiences of Asian American youth during COVID-19. Journal of Adolescent Research. https://doi.org/10.1177/07435584221100680
Sue, D. W., Capodilupo, C. M., Torino, G. C., Bucceri, J. M., Holder, A. M. B., Nadal, K. L., & Esquilin, M. (2007). Racial microaggressions in everyday life: Implications for clinical practice. American Psychologist, 62(4), 271–286. https://doi.org/10.1037/0003-066X.62.4.271
Tran, A. G. T. T., Mintert, J. S., & Le, T. P. (2021). Coping with discrimination among Asian Americans: A meta-analytic review. Journal of Counseling Psychology, 68(4), 505–520. https://doi.org/10.1037/cou0000539
Wang, S., & Le Bail, H. (2023). Racisme anti-Asiatiques en France : Discriminations banalisées et invisibilisation. CNRS / Défenseur des droits. [Disponible via les communiqués de presse et la synthèse Le Point / AFP, mars 2023]
Yip, T., Cheon, Y. M., Wang, Y., Cham, H., Tryon, V., & El-Sheikh, M. (2019). Racial disparities in sleep: Associations with discrimination and academic outcomes in Chinese American adolescents. Journal of Youth and Adolescence, 48(3), 568–580. https://doi.org/10.1007/s10964-018-0934-1