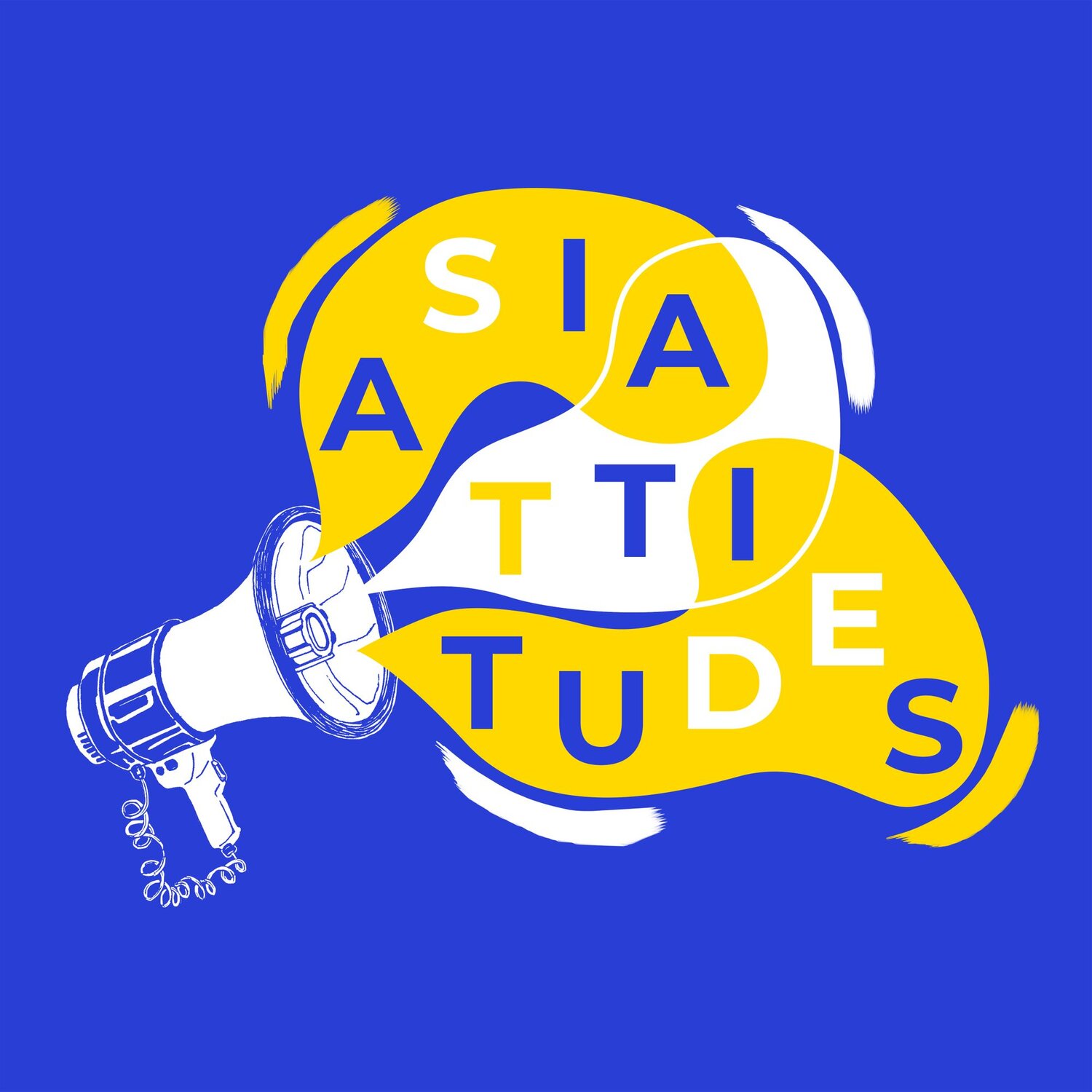Qu’est-ce que le racisme anti-asiatique ?
Silencieux, banalisé, peu dénoncé : le racisme envers les personnes d’origine asiatique reste encore largement invisibilisé en France. Pourtant, il s’inscrit dans une histoire longue, faite de stéréotypes anciens, de discriminations et d’exclusions systémiques. Comprendre ce racisme, c’est faire le premier pas vers sa reconnaissance et sa dénonciation.
Un racisme banalisé mais bien réel
Le racisme anti-asiatique désigne l’ensemble des discriminations, préjugés, moqueries ou violences subies par les personnes perçues comme asiatiques, qu’elles soient originaires d’Asie de l’Est, du Sud-Est, du Sud, du Centre ou de toute autre région du continent asiatique. Cette forme de racisme repose sur des stéréotypes raciaux, culturels ou religieux, et touche des personnes aux origines diverses, souvent réduites à une image homogène et exotisée de "l’Asiatique". Souvent, il est banalisé, minimisé, voire considéré comme « moins grave » que d’autres formes de racisme. Cette banalisation s’explique en partie par le stéréotype de la « minorité modèle », selon lequel les personnes asiatiques seraient discrètes, travailleuses et bien intégrées, et donc peu concernées par le racisme. Mais derrière cette image flatteuse se cache une réalité faite de discriminations, d’injustices et de violences.
Des stéréotypes hérités de l’histoire coloniale
Ce racisme ne date pas d’hier. Il s’ancre dans l’histoire coloniale, les migrations forcées et l’idéologie racialiste du XIXᵉ siècle. En Occident, « l’Asiatique » a longtemps été perçu comme un étranger indésirable, entouré de fantasmes et de peurs. Cette peur s’est traduite dans des politiques discriminatoires, comme le Chinese Exclusion Act aux États-Unis ou l’Immigration Restriction Act en Australie, nourries par le mythe du « péril jaune », qui imaginait une invasion de l’Occident par les masses asiatiques.
En France, les stéréotypes issus de la colonisation ont durablement marqué les représentations : le Cambodgien serait « doux mais paresseux », le Chinois « travailleur mais sournois », le Vietnamien « intelligent mais fourbe »… Chaque qualité supposément « positive » est systématiquement inversée pour dévaloriser les personnes qu’elle désigne.
Des clichés qui enferment : « minorité modèle » et « éternel étranger »
Ces stéréotypes persistent aujourd’hui sous de nouvelles formes. L’image de la « minorité modèle », qui présenterait les personnes asiatiques comme silencieuses, studieuses et irréprochables, contribue à invisibiliser le racisme qu’elles subissent, tout en leur imposant une pression constante à la réussite.
Parallèlement, le stéréotype de « l’éternel étranger » maintient l’idée que les personnes asiatiques ne seraient jamais vraiment « d’ici », même lorsqu’elles sont nées en France. Cette perception alimente des micro-agressions quotidiennes (« Tu parles bien français ! ») et renforce leur exclusion symbolique dans la société.
Des violences qui perdurent en France
Aujourd’hui encore, le racisme anti-asiatique prend des formes variées : insultes racistes (« niakoué », « chinetoque »), moqueries banalisées dans les médias, stigmatisation dans l’espace public, et parfois violences physiques, comme l’agression mortelle de Zhang Chaolin à Aubervilliers en 2016.
La pandémie de Covid-19 a amplifié ces discriminations, réactivant des stéréotypes anciens associant les Asiatiques aux maladies et à la menace sanitaire. De nombreuses personnes ont été prises pour cible, verbalement ou physiquement, dans un climat d’indifférence généralisée.
Une étude menée en France entre 2020 et 2022 montre que ce racisme s’exprime surtout dans l’espace public, à l’école ou au travail, souvent sous forme de « blagues » ou de remarques humiliantes. Ces agressions produisent chez les personnes concernées un mélange de honte, de colère et un sentiment d’illégitimité à dénoncer ce qu’elles vivent.
Il est important de rappeler que l'expression « personnes d'origine asiatique » regroupe une grande diversité d'identités, d'origines et de parcours souvent invisibilisés derrière cette catégorie unique. Si le sentiment d'être perçu comme « différent » est largement partagé, les formes que prend le racisme anti-asiatique varient considérablement. Certaines personnes sont perçues comme une menace potentielle, d'autres subissent des violences physiques ou des discriminations marquées par le genre, tandis que certaines font face à des discours haineux en ligne ou à des représentations stéréotypées dans les médias. D'autres encore sont exposées à d'autres formes de discriminations religieuses, soulignant que le racisme anti-asiatique se conjugue souvent à d'autres oppressions.
Reconnaître pour mieux lutter
Le racisme anti-asiatique est ancien, multiforme et souvent invisible. Il s’exprime dans les interactions quotidiennes, les institutions, et les représentations culturelles. Le reconnaître est déjà une première étape pour le combattre.
Dans le prochain article, nous explorerons les effets psychologiques du racisme anti-asiatique, pour comprendre comment il affecte le bien-être, l’estime de soi et le sentiment d’appartenance des personnes concernées.
Références
Cheah, C. S. L., Wang, C., Ren, H., Zong, X., & Leung, C. Y. Y. (2020). COVID-19 racism and mental health in Chinese American families. Pediatrics, 146(5), e2020021816. https://doi.org/10.1542/peds.2020-021816
Défenseur des droits. (2020). Discriminations et origines : l'importance de l'origine dans le vécu des discriminations en France. Paris : Défenseur des droits.
Kastoryano, R. (2010). Les minorités : identités, discriminations et citoyenneté. Presses de Sciences Po.
Réseau Canopé. (s.d.). Racisme anti-asiatiques. Éduquer contre le racisme et l'antisémitisme. Consulté le 6 juin 2025, sur https://www.reseau-canope.fr/eduquer-contre-le-racisme-et-lantisemitisme/racisme-anti-asiatiques.html
Patrimoine canadien. (2024). Lutter contre le racisme envers les personnes d’origine asiatique. Gouvernement du Canada. Consulté le 6 juin 2025, sur https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/mois-patrimoine-asiatique/contre-racisme-asiatique.html
Simeng Wang, & Le Bail, H. (2023). Racisme anti-Asiatiques en France : discriminations banalisées et invisibilisation. CNRS / Défenseur des droits.
Sue, D. W., Capodilupo, C. M., Torino, G. C., Bucceri, J. M., Holder, A. M. B., Nadal, K. L., & Esquilin, M. (2007). Racial microaggressions in everyday life: Implications for clinical practice. American Psychologist, 62(4), 271–286. https://doi.org/10.1037/0003-066X.62.4.271